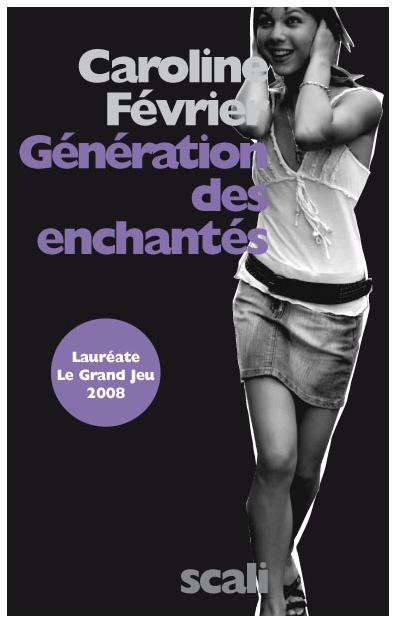
Cours de français. La prof, très (trop) généreuse, a décidé de nous offrir un package de quatre heures de cours dans la même journée pour, dit-elle, « boucler le programme ». C’est trop gentil, merci. Et pendant que je crève d’ennui sur ma chaise, noyée dans mes songes, insensible, ladite prof s’applique à disséquer les plus beaux textes de la littérature française avec une précision chirurgicale. Les mots sont alors dépossédés de toute leur magie, les phrases perdent leur sens, c’est la beauté sacrifiée au profit du savoir. Depuis toujours, on nous inflige ces exégèses sans queue ni tête qui transforment les plus belles phrases en couteaux tranchants, dangereux et tristes. La magie s’efface et les perles roulent dans la fange : on part alors à la chasse aux figures de style, aux allitérations, aux assonances, quête frustrante où la réalité l’emporte toujours sur les rêves.
Rimbaud ou Lamartine n’auraient sûrement pas voulu que l’on fasse de leurs poèmes ces tombeaux où l’on balance impunément les vocables morts, ces rings où s’affrontent sans pitié consonnes et voyelles, ces étals où l’on expose fièrement les viscères froids de leurs plus belles pensées. Non, ils auraient sans doute préféré que l’on s’imprègne de leurs mots, que l’on déguste cette magie de la littérature qu’ils nous offrent sans attendre de retour, que l’on trouve en leurs phrases une formidable catharsis : qu’il y a-t-il de plus beau en effet, pour un écrivain, que de savoir que ses mots aident à résorber la souffrance de ceux qui la lisent ?
Pendant que mes camarades et moi gémissons de douleur, penchés au dessus de l‘intrigue inexistante de Pierre et Jean, la prof se fait chercheur d‘or et nous entraîne dans sa quête de la métaphore, de l‘asyndète, de la litote, de l‘hypallage, et autres malsaines pépites. L’école nous a appris à considérer la littérature comme un sacerdoce, science inversée de celle des artistes qui n’ont pas de réponses à donner, mais des milliers de questions à poser. Les livres se font champ de bataille, les mots, cadavres sanglants. Les mondes imaginaires que nous offre la littérture restent alors suspendus dans le lointain, couverts d’une poussière étrange, leur porte hermétique close.
Je ressortais des cours lasse et fatiguée, sans comprendre pourquoi l’école, sous couvert d’épanouir ses élèves, se borne à leur faire étudier les livres les plus chiants de la littérature. Nos désirs fragiles, nos hésitations à pénétrer dans le sanctuaire des grands auteurs sont balayés : c’est par la grande porte que nous sommes forcés d’entrer dans l’univers magique et austère des mots, là où les livres agissent comme des coups de poignard.
La littérature est mon refuge, le socle de mes émotions, le piédestal de mes pensées : combien de fois ai-je admiré tel ou tel auteur pour sa prose, ses aphorismes, ses fulgurances poétiques, ses éclairs dans un ciel trop vide, pour cette douce échappatoire qu’il me proposait !
J’aime que le mot, avant d’être un refuge, soit un palindrome : une arme et une caresse tout à la fois. Et pourtant je comprends l’aversion de certains pour les lettres. L’école ne nous a jamais appris à nous lier d’amitié avec les livres, à nous en faire des compagnons de voyage, des maîtres de liberté : c’est sous son jour le plus austère qu’elle aprésenté la littérature, et l’exode de toute une génération ayant fui l’imaginaire pour l’art consommatoire ne lui en est que plus imputable.
Ma culture littéraire est basée sur un mensonge : bien sûr, les grands ouvrages de la littérature ne me sont pas étrangers, mais j’avoue sans honte ne pas les avoir lus. J’ai pourtant essayé, je le jure ! J’ai serré dans mes mains les plus beaux livres pour m’en faire des compagnons de voyage, j’ai tenté de m’accrocher à cette mythologie intellectuelle, à cette invisible splendeur que l’on m’avait promise, à ces phrases gravées dans l’histoire du monde, j’ai essayé de me persuader de leur beauté, de leur profondeur, de leur vérité universelle. Et puis, à la fin du combat, j’ai sombré dans un irrémédiable ennui, marquée au cœur par les séquelles blanchâtres, assurément triste d’avoir échoué dans ma quête. Nourrie à la littérature moderno-trash du troisième millénaire, amoureuse du cynisme, de l’absurde, de la violence verbale et du nihilisme vomitif d’une nouvelle génération d’écrivains, je glisse sur le génie des (m’a-t-on dit) grands auteurs. Mea culpa : mon amour de la littérature est tristement béotien. Il est pourtant de bon ton, à notre époque, de se retourner sans cesse sur le passé : oh comme c’était mieux avant ! comme les écrivains étaient doués ! comme leurs écrits étaient jolis, profonds, recherchés ! En matière d’art, la qualité ne se conjugue qu’au passé. Les génies sont morts, et personne n’a été foutu de prendre la relève : alors baladons-nous dans les cimetières, exhibons les cadavres, humons l’odeur de charogne qui plane sur ces spectres blafards ! Mais à trop se pencher sur la mythologie du temps passé, on en oublie les victoires du présent. On apprend aux écoliers candides à discerner le vrai du faux, le réel de l’artificiel, la merde de la qualité. La liste des auteurs immortels est longue, et surtout imposée : c’est un point à la ligne, une absence de contestation, un déni de l’esprit critique : pensez comme nous et vous serez récompensés. Et l’on se sent alors tellement sot de préférer ses bouquins de science-fiction à un roman du XIXème siècle, tellement coupable d’éprouver plus de plaisir à lire un Harry Potter qu’un Madame Bovary ! Citer les grands auteurs, rien de mieux pour épater son interlocuteur ; se vanter d’avoir fini le dernier roman de Marc Lévy, idéal pour le faire fuir. La contemporanéité n’est pas sèrieuse : elle est poussiéreuse.
Ah ! Tu connais pas Voltaire ? Comment ça, tu n’as jamais lu Eugénie Grandet ? Airs déçus, parfois méprisants, sentiment de supériorité culturelle. Je ne supporte pas l’idée de lire pour répondre à une demande, en l’occurrence celle de la culture, lire pour être moins con, lire pour pouvoir briller dans les cocktails, moi j’ai lu ci, moi j’ai lu ça, c’est Machin qui a dit que, et comme l’a écrit Truc… De la bave intellectuelle. Pour moi la lecture se base uniquement sur le plaisir : qu’importe si le bouquin a été dégommé par les critiques littéraires de Télérama puis rangé dans la catégorie « roman de gare pour veaux satisfaits » pourvu que ses mots m’apaisent.
Nous sommes, pauvres adolescents désoeuvrés, à des milliers de kilomètres d’une princesse de Clèves ou d’un Julien Sorel. Les « grands écrivains » savaient disserter sur le sens de l’existence, mais ne nous tendront jamais de perches pour nous sauver de la noyade, à nous qui ne désirons que du sang, des brûlures, de la vérité. Nous utilisons les mots comme des armes : l’idée qu’un livre puisse se faire le médiateur de nos combats nous est complètement étrangère.
Je ne lirai jamais Balzac, je ne lirai jamais Zola, je ne lirai jamais Nerval. Je n’aurai jamais la culture nécessaire pour pouvoir rivaliser avec ces intellectuels hitlériens qui se gaussent de l’ignorance de la plèbe, elle qui n’a jamais consenti à se prendre la tête pour déchiffrer les axiomes masturbatoires d’une génération de philosophes méprisants. Je ne serai jamais concernée par les débats d’idées que certaines émission littéraires organisent parfois, grandes foires au voyeurisme où le but du jeu est de démontrer, à grands renforts de citations littéraires, qui a la culture la plus étendue et la plus grosse quéquette.
Quelle déception ! Je resterai à jamais ce mignon bibelot inculte, que l’on pose dans son salon pour faire joli. N’oublions pas que le monde des femmes se divise en deux : les bimbos sexy mais connes et les intellos moches que personne ne baise. Il ne me reste plus désormais qu’à acheter les livres de Marc Lévy, vernir mes ongles de rose, accrocher des reproductions d’art à mes murs, pousser des cris de chatte en chaleur dès qu’un individu de sexe masculin ouvrira la bouche, porter des jupes aussi longues qu’un cache-sexe, brancher mon aspirateur, et je serai une femme accomplie.


